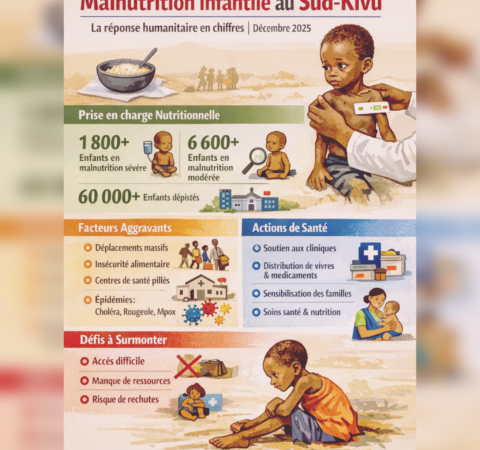RDC : les attributions ministérielles au cœur du désordre institutionnel

Avec le gouvernement Suminwa II formé en août 2025, la République démocratique du Congo se retrouve une fois encore face à une vieille maladie institutionnelle. Il s’agit de l’absence d’ordonnances d’attributions ministérielles à jour. Ainsi, beaucoup d’entre eux fonctionnent sans un périmètre de leurs attributions. Ce qui ouvre la voie à une gestion informelle, indique Ebuteli, cette institution de recherches, dans sa Thématique du mois de novembre.
Depuis 2019, cinq gouvernements se sont succédé sans publication rapide de ces textes essentiels. Le dernier remonte à janvier 2022. « Le gouvernement fonctionne sans boussole claire », constate Ebuteli dans sa note thématique publiée en octobre 2025. « Ce vide juridique fragilise la cohérence de l’action publique et accroît les risques de chevauchements », dit encore la note.
Cette absence de cadre légal précis plonge l’exécutif dans une gestion informelle. Ainsi, l’on assiste souvent aux arbitrages politiques, des lettres de mission, et des instructions ponctuelles. Des mécanismes de substitution qui déplacent, selon Ebuteli, « le centre de gravité institutionnel entre les mains du Premier ministre, alors que la Constitution réserve cette compétence au président de la République après délibération en Conseil des ministres ».
Conflits de compétences : quand deux ministres signent le même arrêté
Ce flou ne reste pas théorique. En 2023, un bras de fer oppose Peter Kazadi, vice-Premier ministre de l’Intérieur, à Eustache Muhanzi, ministre de la Décentralisation. Les deux revendiquent le droit de nommer les chefs de secteur. « Faute d’une ordonnance d’attributions actualisée, cette ambiguïté s’est transformée en affrontement ouvert », explique le rapport.
Le Conseil d’État tranchera en faveur du ministère de l’Intérieur, mais le mal est plus profond. Plusieurs ministères se disputent des champs d’action similaires. C’est le cas de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, des affaires foncières, ou encore du numérique et de l’économie.
Ebuteli note qu’« il est arrivé plusieurs fois qu’un service communal refuse un titre à un usager, mais que celui-ci l’obtienne auprès d’un autre service dépendant d’un ministère voisin ». Cette dérive illustre une administration désorientée, où l’absence de textes à jour favorise la confusion, la lenteur et la rivalité. D’où l’importance de mettre en place régulièrement des textes sur les attributions ministérielles.
La présidence, un exécutif dans l’exécutif ?
Au-delà du gouvernement, la Présidence de la République a développé ses propres structures exécutives. Cette institution dispose de ses agences, de services spéciaux, de cellules thématiques et tant d’autres. Le rapport cite notamment l’Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable (ACTEDD), rattachée directement au chef de l’État, et investie de missions très proches de celles du ministère de l’Environnement.
« Cette superposition d’entités entretient une concurrence implicite entre structures et fragilise la cohérence de l’action publique », analyse Ebuteli. « La multiplication des services rattachés à la Présidence a progressivement transformé le Palais de la Nation en un centre parallèle de décision et d’exécution. » En conséquence, la frontière entre pilotage politique et exécution administrative s’efface.
Qui rend compte en cas d’échec d’un programme ? Le ministre ou le conseiller présidentiel ? Cette question, au cœur de la note d’Ebuteli, met en lumière une recentralisation du pouvoir qui mine le principe de collégialité gouvernementale.
Lire aussi : RDC : Suminwa II, un gouvernement politiquement élargi ?
Ministres délégués : le flou hiérarchique
Le gouvernement Suminwa II compte cinq ministres délégués. Mais seuls leurs titres sont connus. En revanche, leurs missions, elles, ne le sont pas. L’ordonnance de 2022 ne mentionne que celui chargé des personnes vivant avec handicap. « Pour les autres, l’intitulé de nomination délimite un domaine d’intervention sans préciser les contours », souligne le rapport.
Cette imprécision alimente les tensions. En 2024, la ministre déléguée à l’Environnement démissionne sur fond de désaccords avec sa supérieure. Ebuteli y voit une dérive structurelle. « Là où les vice-ministres disposent d’un cadre hiérarchique bien défini, les ministres délégués évoluent dans un flou institutionnel persistant. » Autrement dit, un outil conçu pour renforcer la coordination finit par l’affaiblir.
Réformer pour clarifier
Pour sortir de ce flou chronique, Ebuteli avance cinq pistes de réforme prioritaires. Il s’agit de fixer un délai légal de 30 jours maximum après la formation du gouvernement pour publier les ordonnances d’attributions ministérielles. Cette institution propose également la clarification des ministres délégués, en définissant clairement leurs prérogatives. Elle propose également de recentrer la présidence sur des missions de planification stratégique. Et enfin Créer un mécanisme d’arbitrage interne au gouvernement pour trancher les conflits de compétences. et rationaliser la taille du gouvernement, avec un modèle plus lisible et fonctionnel.
« La multiplication des portefeuilles ministériels, souvent dictée par des équilibres politiques plus que par des considérations administratives, fragilise la coordination et la lisibilité de l’action publique », conclut Ebuteli.